|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Forum] | [Contact e-mail] |
|
||||||
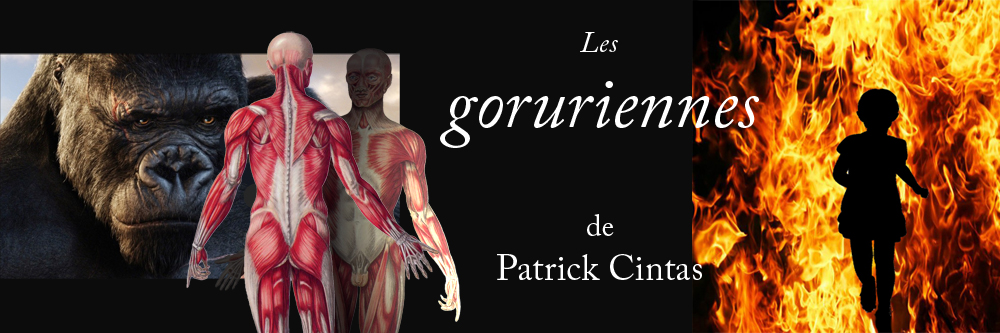 |
||||||
|
| Navigation | ||
|
Quelques entretiens avec Patrick Cintas
Marie SAGAIE-DOUVE
 oOo
Marie SAGAIE-DOUVE
Le silence 
Nous nous sommes un peu chamaillés toi et moi à propos de la question de savoir si ta poésie est plutôt lyrique ou plutôt narrative ou épique. Personnellement, moi qui en littérature ai beaucoup de maîtresses et peu de maîtres, je penche pour le roman, une poésie du roman. Pas de chansons, une narration capable de créer l’héroïne. La réception de mes textes dépasse le domaine de ma compétence. Devenu maître du jeu, le lecteur, à l’aide d’indices repérés sur le chemin, crée son texte, sur le dispositif qui lui est proposé. En revanche, si l’on entre dans le processus, l’émotion y joue un rôle d’importance, sur un mode archaïque, privilégiant les figures du conte et quelques mythes. Le récit, tentation de la mémoire, organise le bric-à-brac en rythmes et sons. Les images fonctionnent comme des scènes furtives. Leur lien incertain rappelle les associations du rêve. Au lecteur d’éclaircir ce rébus, d’être touché par le désenchantement de l’épique dans cet espace de l’esquisse, de l’étude réduite au fragment glissant vers la prose dans Lignes de fuite. Le travail porte sur le sujet - ou ce qu’il en reste - dans une énonciation saccadée voire déjantée.
Tu attaches une importance cruciale au silence ou au blanc, selon la musique ou la page. Que représentent ces silences : le non-dit (tabous), l’attente, l’indicible ? Le silence touche le processus. Il sert aussi de ponctuation. Il crée le rythme, forme le sens. Il représente l’avant des mots, leur écho, leur résonance, le vide qu’ils laissent – comme après un coup de gong. Leur impact laisse silencieux le texte. L’aspect musical reste décisif, telle une respiration, une mise en relief qui fait effet sur le dire, plutôt que le non-dit, lequel demeure second comme évidement par où s’élaborent, dans l’implicite, mes textes. A l’origine, plutôt compacts comme « ce qui vient » dans le cabinet de l’analyste ou le silence de la chambre d’écriture. L’attente fait partie du jeu, mobilise par à-coups des matériaux contrastés, sollicite ce qu’il y a de latent dans l’acte qui met en jeu la langue, lequel ne laisse de prendre à la gorge. Quelque chose - qui s’est inscrit - se révèle. Autant le dire tout de suite : c’est l’écriture féminine qui te passionne. Que penses-tu de la part de féminité chez l’écrivain mâle ? Assez récemment, j’ai interrogé certaines écritures féminines. Au cours de ce travail – à poursuivre -, ai constaté que la double appartenance, masculine et féminine, traversait les textes étudiés. Le féminin n’est pas réservé à la femme. Dans Les Fleurs du mal comme dans Don Quichotte, c’est visible. Et si le corps féminin filtre différemment le rapport à l’autre et au monde, les identifications aux images se chargent de brouiller les pistes. Finalement, l’écriture joue à l’androgyne. Sur cette ligne indécise, qui sépare et relie, le temps se transforme en représentation. D’ordinaire, on installe la scène dans le temps. La durée, au théâtre, conditionne tout le reste. Au contraire, chez toi, un espace se construit. On dirait même que tu le construis pour y installer tes personnages. Histoire ne conviendrait-il pas mieux que traversée ? L’espace, qu’ouvre le texte, traverse une confusion. Il y a peu de place pour des personnages. Condamnée au ressassement, tel l’oiseau tournoyant au-dessus d’une proie, l’énonciation emprunte des masques. Dans un temps morcelé, sans histoire véritable. L’homme est-il mort et seule la femme vivante, voire vivifiée par le texte ? L’homme. Lequel ? Dans les scènes primitives, autant que je me souvienne, il est terrifiant. Plus tard, il s’apparente au revenant. La femme, quant à elle, serait happée par Méduse et, sur le versant archaïque, sa parole mime les lallations. Une façon d’être réduite au silence, au retour du même, à la mam’langue, dans un pays des merveilles devenu mamoland. Se dissimulant sous ma langue, l’infans renvoie au silence. C’est le cri de la blessure qui émane de ton texte, rarement ou peut-être jamais l’angoisse des conséquences. Tu n’as pas peur ? Le cri monte de l’animal. Cri étouffé par les voix qui dominent. Le tableau éponyme de Munch illustre cette impasse. La blessure en revanche est une origine, renvoie à l’enfant mort dans l’avant-temps de l’écriture. Primate asexué, à l’état de fœtus dans les limbes, terrassé par la stupeur de l’exil. Une mort déjà là, que l’écriture prolonge. |
|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Contact e-mail] |