|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Forum] | [Contact e-mail] |
|
||||||

| Navigation | ||
 oOo
Léon Bloy, les leçons d’un entrepreneur de démolitions
Benoît PIVERT 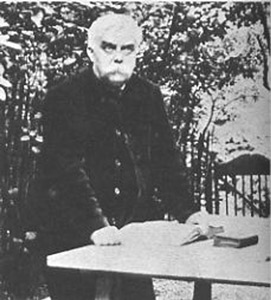
Léon Bloy (1846-1917) s’est-il attiré, par l’effet de quelque secrète justice, l’ingratitude de la postérité en se décernant lui-même le titre de « mendiant ingrat » ? Toujours est-il que l’écrivain fait partie de ces quelques maudits qui, dans ma jeunesse, ne trouvaient place dans aucun manuel scolaire et qui, aujourd’hui encore, en sont toujours exclus comme si aucun espace, ne fût-ce qu’une simple mention ne leur revenait dans l’histoire de la littérature française. Quels ignobles péchés faut-il donc avoir commis pour se voir fermer ainsi les portes des recueils de morceaux choisis ? Pour une école qui se veut laïque, peut-être Léon Bloy n’est-il qu’un assommant cagot, à moins que l’école de la République ne lui pardonne guère de n’avoir porté aux nues précisément ni la République ni le suffrage de la multitude. Certes, beaucoup ont fini comme moi par découvrir Léon Bloy un jour au hasard des rayonnages d’une bibliothèque et Léon Bloy compte, je le sais, parmi ces écrivains qui, par le biais du bouche à oreille, suscitent des cercles d’inconditionnels mais il est néanmoins regrettable que la jeune génération continue à être privée de la découverte d’un écrivain dont elle aurait pourtant tant à apprendre, que ce soit à travers son journal, ses volumes de critique littéraire tels que Belluaires et Porchers ou encore ses romans comme Le désespéré.
La première leçon que délivre celui qui se définissait lui-même comme un « entrepreneur de démolitions »[1] est une formidable leçon d’irrespect à l’encontre de toutes les vaches sacrées de la littérature, du journalisme et de la politique, et c’est d’ailleurs en cela que Bloy aurait de quoi séduire les plus jeunes, à travers cette fureur iconoclaste érigée en art d’écrire, ce ton politiquement incorrect avant l’heure. L’exercice est d’autant plus admirable qu’il était suicidaire car Bloy, qui vécut souvent dans la misère – parfois la plus noire – passa une partie de sa vie à se brouiller avec les puissants de la presse et de la littérature qui auraient pu le nourrir. S’il advenait qu’ils lui ouvrent leur porte, ils s’empressaient de la lui refermer au nez, horrifiés par l’intransigeance et le toupet d’un vociférateur qui venait cracher dans la soupe, éreinter les écrivains en vogue et traîner dans la boue les confrères trop accommodants avec les idoles du moment. Mais Bloy n’est pas seulement un braillard et un mauvais coucheur, c’est un entrepreneur de démolitions dont l’humour fait mouche. Lorsqu’il s’en prend à Paul Bourget, l’écrivain salonnard et précieux qui fait se pâmer ces dames devient « le Psychologue d’entre les castrats, - qui débuta, presque enfant, par d’exécrables poèmes dont la lecture, à voix distincte, eût été capable de constiper les bestiaux[2] »… Et il en va ainsi pour bien des monuments littéraires du moment, à commencer par Zola à qui Bloy voue une détestation toute particulière qui réjouirait, à n’en pas douter, les bataillons de lycéens obligés d’ingurgiter et d’admirer L’assommoir ou La bête humaine. Pour Bloy, Zola est le Napoléon de la crotte qui, chaussé de bottes d’égoutier, explore à l’envi les canalisations putrides du naturalisme. Celui qu’il surnomme « le crétin des Pyrénées » n’est à ses yeux qu’un noircisseur de pages chez qui l’on chercherait en vain l’atome d’une idée. Il y a bien sûr quelque excès dans tout cela mais le comique ne naît-il pas de l’exagération ? Or c’est précisément ce comique, cette outrance jubilatoire, cette hargne ivre d’elle-même qui séduisent chez Bloy, malheureusement trop souvent présenté fadement comme « écrivain catholique ». Certes, catholique, Bloy, l’est à n’en pas douter mais il n’y a rien qui lui fasse tant horreur que les « écrivains catholiques », mièvres, sirupeux ou, pour reprendre un adjectif bloyen, « melliflues », tels les François Coppée et autres « colonnes de l’Eglise ». Dans un morceau d’anthologie contenu dans son journal des années 1907-1910 (Le vieux de la montagne), Bloy s’en est pris à cette race délicate dont les mérites étaient vantés à l’époque par un certain abbé Louis Bethléem dans un ouvrage intitulé Romans à lire et romans à proscrire ainsi que l’abbé Fonssagrives dans L’éducation de la pureté. Dans son compte rendu de ces lectures édifiantes[3], Bloy, catholique mais pas idiot, se moque allègrement des « romans honnêtes » de Claire de Chandeneux, de Gui Chantepleure, « de son vrai nom Jeanne Viollet, auteur de Ma conscience en robe rose »[4], de Mme Craven ou encore Zénaïde Fleuriot et ses 83 ouvrages « pleins de finesse et d’entrain[5] ». Bloy est tout autant pamphlétaire que catholique et son catholicisme ne le retient de s’attaquer ni au pape et à ses atermoiements durant la Grande guerre, ni aux abbés mondains ni encore aux religieuses du beau monde comme une certaine mère Mercedes à qui Bloy ne pardonne pas ses allures de grande bourgeoise insensible à la misère. Tel est chez Bloy le sens de la justice et du respect dû aux pauvres. Implacable, impitoyable, intraitable. Si Bloy peut se permettre de donner des leçons, c’est qu’il connaît la vie. A travers son journal, c’est un pauvre qui parle, un habitué des logements insalubres dans lesquels on gèle en hiver et on suffoque en été mais dont on vous expulse au moindre terme oublié. Bloy sait quels tourments traverse un indigent dont la femme est malade mais qui n’a pas le sou pour payer le médecin. Il connaît la honte des fins de mois difficiles, lorsque tous les commerçants refusent le crédit et qu’il faut aller mendier le pain chez le boulanger. C’est ce qui donne à son Journal une telle force et qui explique la genèse d’autres ouvrages tout aussi implacables que Le sang du pauvre ou Exégèse des lieux communs. Dans ce dernier, Bloy a, avec beaucoup de drôlerie, décortiqué toutes ces maximes et sentences grâce auxquelles le bourgeois bien-pensant érige l’avarice en sagesse (Un sou, c’est un sou), ne pratique sa foi que les dimanches et jours fériés en se montrant, les jours ouvrables, le pire des gredins et parvient encore à interdire aux affamés de pleurer sous prétexte que les grandes douleurs sont muettes. On ne peut que rire jaune tant on soupçonne derrière l’humour corrosif de douleurs rentrées. Bloy n’a pas oublié, par exemple, la mort de Berthe Dumont, une morphinomane qui errait de par les rues en tendant la main pour secourir sa mère. N’écoutant que son bon cœur, il avait recueilli la mère et la fille, d’abord à Asnières, puis à Fontenay-aux-roses. Le 10 mai 1885, Berthe Dumont fut frappée de tétanos. « Les muscles de son corps avaient de telles contractions qu’elles broyaient les os[6] », nota Huysmans. Bloy sortit dans la nuit pour mendier de l’argent afin de faire soigner la mourante. On ne lui donna rien. Il n’a pas oublié. C’est pourquoi dans son oeuvre, n’en déplaise aux bourgeois, les grandes douleurs ne sont pas muettes. Elles crient vengeance et, page après page, attisent la fureur de l’écrivain. Les colères de Bloy ne sont pas seulement redoutables, elles sont aussi admirables car elles s’expriment dans une langue qui fait de l’œuvre l’un des joyaux du raffinement stylistique fin de siècle. Et c’est là encore l’une des leçons de l’entrepreneur de démolitions. On peut vouer aux gémonies le bourgeois, éreinter les plumitifs et damner les propriétaires sans jurer comme un charretier mais, au contraire, en jetant à la figure de tous de petits bijoux bien ciselés aux arêtes bien acérées. Bloy est un homme animé par l’amour des mots incisifs et qui sait faire partager à ses lecteurs sa passion. On se surprend soudain à noter fébrilement toutes les trouvailles lexicales qui abondent. Bloy a écrit de Huysmans qu’il avait le prurit de l’adjectif rare. Huysmans aurait pu retourner le compliment à l’envoyeur. « Irrémissible », « immarcescible », « hispide », « calamistré » et autres adjectifs aujourd’hui tombés en désuétude fourmillent sous la plume de Bloy. Paul Bourget se voit traiter d’« icoglan littéraire[7] », un de ses confrères de « méridional démantibulé, besacier roublard des littérateurs autochtones et des romanciers anglais, dont il revernit de son mucus les vieux godillots pour accabler d’admiration les entrepreneurs de sa gloire »[8], la critique de théâtre devient « le maquignonnage putanier de la jugerie dramatique[9] ». On l’aura compris, Bloy se délecte des vocables les plus rares qui constituent le trésor oublié de la langue française. La langue de Bloy est comme un vin précieux qui aurait mûri pendant une éternité dans de vieux fûts de chêne. C’est un plaisir que de savourer cette langue, d’en explorer tous les registres, ainsi dans ce portrait du visage de Renan dans lequel l’auteur passe successivement de l’arboriculture à l’histoire de l’Antiquité : « Face glabre, au nez vitellien, légèrement empourpré et picoté de petites engrêlures qui tiennent le milieu entre le bourgeon de la fleur du pêcher et les bubelettes vermillonnes d’un pleurnichage chronique, assez noblement posé, d’ailleurs, au-dessus d’une fine bouche d’aruspice narquois et dubitatif, - comme un simulacre romain de la Victoire ailée et tranquille, au bord d’une route tumultueuse de la haute Asie, encombrée du trafic suspect de Babel ou de Chanaan. »[10] La langue de Bloy sent l’héritage des humanités. L’écrivain convoque indifféremment les dieux de l’Olympe ou du panthéon romain. C’est dans la fureur et l’indignation qu’il est le plus éblouissant. Tout y passe, depuis les héros de la mythologie en passant par les noms d’oiseaux rares jusqu’aux mammifères exotiques ou préhistoriques connus des seuls naturalistes. C’est tout un bestiaire de la détestation qui voit le jour sous sa plume. Zola y devient « le Triton de la fosse d’aisances naturaliste, le cloporte vengeur par qui toute ordure est enfin mise à sa vraie place »[11]. Même scatologique, Bloy sait rester élégant. Grâce à lui, le pamphlet n’est plus un simple écrit satirique, il devient un art de l’invective spirituelle. Outre sa richesse lexicale propre à ravir les amoureux de la langue et amateurs de curiosités, l’œuvre de Bloy offre aussi, humainement, une leçon de courage, un art de ne pas désespérer. Pourtant, à la lecture du Journal qui va de 1892 à 1917, les raisons de se décourager abondent. La vie de Bloy apparaît comme un enchaînement de tribulations, mort atroce de sa compagne Berthe Dumont, mort de son jeune fils André, fruit de son mariage avec la Danoise Jeanne Molbech, renvois successifs de diverses rédactions pour incompatibilité d’humeur, déménagements à répétition pour cause d’impécuniosité, nécessité de mendier au sens strict de quoi payer le loyer ou acheter le pain quotidien, trahison d’amis jadis hébergés, rien ne semble avoir été épargné à l’écrivain si ce n’est peut-être la maladie. Pourtant, malgré cet inventaire de désastres en tous genres, Bloy communie chaque jour, porté par l’espérance qu’à la dernière minute le Ciel fera un geste pour qu’il ne plonge pas dans l’abîme. Au plus fort de sa douleur, il ne se retourne pas contre Dieu. Bloy, c’est Job sans ses imprécations ou Job qui a compris que les voies du Seigneur sont impénétrables. Pour le lecteur, croyant ou non, c’est une formidable leçon de courage et de persévérance qui se dessine à travers l’œuvre. Certes cette œuvre a, en notre siècle laïque, de quoi déconcerter car si Bloy n’est pas un « écrivain catholique », son œuvre est portée par le souffle de la foi. Or la foi de Bloy n’est pas une foi tiède, c’est une foi entière, exigeante qui peut rebuter le commun des mortels comme la vue d’un martyr. Bloy croit ainsi fermement à la doctrine de la « substitution » à laquelle il a converti Huysmans. A première vue, cette doctrine a de quoi effrayer ou révolter. Elle signifie que dans l’incommensurable et impénétrable économie céleste, il faut, pour que la balance soit en équilibre, que des justes paient pour racheter les errements des pécheurs. C’est, selon Bloy, l’une des vocations des moines et moniales qui ont choisi la claustration, non seulement pour chanter la gloire de Dieu, mais aussi pour endurer dans les souffrances de leur chair le prix à payer pour le rachat des pécheurs. La souffrance des uns se substitue aux péchés des autres et les efface. On conçoit aisément ce que cette doctrine qui suggère un Dieu assoiffé d’holocaustes peut avoir de monstrueux pour un esprit moderne mais elle explique en partie l’étonnante résignation avec laquelle Bloy accepte sans révolte le sort apparemment injuste qui le frappe. Il sait qu’il doit souffrir pour que des malades guérissent ou que des âmes égarées se convertissent. Ce n’est pas là la seule conviction de Bloy capable de désorienter un lecteur moderne. Bloy a, en effet, consacré une partie de sa vie et de son œuvre à faire connaître le miracle de la Salette, du nom d’un village de l’Isère où en 1846, deux jeunes bergers, Maximin Giraud et Mélanie Calvat, auraient vu la Vierge qui leur aurait parlé alternativement en français et en patois, menaçant les chrétiens de laisser aller le bras de son fils s’ils devaient persister dans l’impiété, leur promettant de retenir ce même bras s’ils devaient s’amender. Finalement, la Vierge délivra aux deux jeunes bergers un secret. Lorsque cette apparition fut connue, les esprits s’enflammèrent. Bloy fut prompt à croire les mises en garde de la Vierge car, depuis trop longtemps, les chrétiens lui semblaient courir à leur perte. Toutefois, un profond scepticisme quant à l’apparition s’exprima dans les diocèses de Lyon et de Grenoble. Bloy n’eut pas de mots assez durs pour condamner les autorités ecclésiastiques qui, à ses yeux, par leur aveuglement compromettaient le salut de l’humanité. C’est ainsi qu’une partie de son Journal comporte de longs plaidoyers pour la Salette qui peuvent rebuter le lecteur d’aujourd’hui. Par d’autres aspects, l’œuvre de Bloy peut prêter à sourire car, avec le recu, il est clair que l’Apocalypse que Bloy pressent à chaque nouvelle catastrophe n’est toujours pas advenue. Pourtant, Bloy ne cesse de clamer dans le désert que les temps sont proches et qu’il faut se convertir. C’est sans doute pendant la Première Guerre mondiale que son catastrophisme apocalyptique connut son apogée. Chaque nouvelle boucherie, chaque nouvelle horreur lui disait que les temps étaient révolus et qu’on assistait aux prodromes du Jugement dernier. Nous savons malheureusement aujourd’hui que l’humanité n’était pas encore à bout de monstruosités et que l’horreur des tranchées que Bloy pensait insurpassable serait bientôt surpassée, sans autre jugement au sortir de l’apocalypse que celui des hommes. Difficile toutefois de dire que Bloy s’est trompé car qu’est-ce que notre mesure du temps au regard de l’Eternité ? Suivre Bloy dans son Journal exige donc un effort, car son sens de l’histoire n’est pas celui du commun des mortels. Albert Béguin note à son propos : « Littéralement le déroulement du temps ne fut pour lui qu’un langage de Dieu, incompréhensible tant que le discours n’est pas achevé, mais dont la signification ne peut-être qu’exactement identique à celle de la Révélation écrite[12] », une interprétation religieuse de l’histoire qui, pour un lecteur d’aujourd’hui, a de quoi déconcerter. C’est parfois humainement que Bloy peut être aussi difficile à suivre. La haine qu’il voue aux Allemands n’a d’égale que son admiration pour Napoléon ou Jeanne d’Arc. Malgré sa haute intelligence, Bloy a du mal, davantage encore durant la guerre de 14, à distinguer les hommes des soldats. Pour lui, l’Allemand est par nature une brute sanguinaire dont la soif exige viols, crimes et autres exactions. A ses yeux, l’esprit prussien résume toute la germanité qu’il croit sincèrement en proie à une possession diabolique. Durant la guerre, il souscrit donc sans réserve aux propos de l’abbé Wetterlé sur les Allemands publiés dans La manière prussienne : « ce sont d’incurables mégalomanes, les maniaques de la force brutale, les virtuoses de la barbarie. Le monde ne retrouvera la paix que le jour où la Prusse n’existera plus ou sera redevenue la pauvre et impuissante principauté de Brandebourg. »[13] Il convient de dire à la décharge de Bloy que la lecture quotidienne des exactions commises par l’envahisseur ne pouvait, chez un homme de tempérament bouillonnant, que susciter un sentiment d’impuissance et de rage. Bloy est peut-être plus « choquant » – et il a indigné – lorsque son humour ne recule devant aucune limite. On le savait coutumier des éloges funèbres irrespectueux propres à faire se retourner le défunt dans sa tombe mais jamais, aux yeux de la France bien-pensante, l’écrivain ne s’était réjoui avec autant d’ignominie que lors de l’incendie du Bazar de la Charité. Rappelons brièvement les faits : un grand nombre de dames du beau monde (son Altesse Royale la duchesse d’Alençon, la duchesse de Vendôme ou encore la duchesse d’Uzès) ont décidé en 1897, pour faire œuvre de charité, d’installer des stands sous un hangar en bois dont l’allée centrale figure une rue médiévale bordée d’échoppes aux noms évocateurs comme A la truie qui file ou Au chat botté. Le produit des ventes de lingerie ou colifichets sera reversé aux plus démunis. D’autres attractions sont proposées comme la projection du film des frères Lumière, L’arroseur arrosé. A proximité de la lampe du cinématographe, un incendie se déclare. Tout le décor en bois s’enflamme. Les douze cents invités tentent de s’enfuir mais en quelques minutes, tout n’est plus qu’un gigantesque brasier. On dénombrera 129 morts sur lesquels 123 femmes de souche aristocratique. Tous les journaux narrent les détails héroïques comme ces dernières paroles de la duchesse d’Alençon qui aurait répondu à une religieuse effondrée « Oui, mais dans quelques minutes, pensez que nous verrons Dieu ! ». Paris pleure ses morts. La France est effondrée. Seul Léon Bloy jubile : « J’ai eu la sensation nette et délicieuse d’un poids immense dont on aurait délivré mon cœur. Le petit nombre des victimes, il est vrai, limitait ma joie[14]. » Pour Bloy, toutes ces belles dames de l’aristocratie devaient périr, elles qui ordinairement n’ont cure de la parole de St Matthieu : « Il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d’une aiguille que pour un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » Il ricane : « Elle n’est pas non plus pour toi, cette parole, n’est-ce pas marquise ? Tout le monde sait que l’Evangile fut écrit pour la canaille, et tu aurais joliment reçu celui qui aurait osé te conseiller de vendre in abscondito tes trompettes et tes falbalas pour le soulagement des malheureux ! Mais tout de même tu recevras « ta récompense »et, demain matin, ô vicomtesse, on vous ramassera à la pelle avec vos bijoux et votre or fondus dans les immondices[15] ». Là où tous s’indignent d’une injustice divine, Bloy dénonce la comédie de la charité, l’attroupement de rombières aristocratiques venues soulager leurs consciences à bon compte. Tandis que le père Bailly parle de ce « bûcher où les lys de la pureté ont été mêlés aux roses de la charité[16] », Bloy crie à la mascarade : « Songez donc ! Des personnes si riches, en toilettes de gala et qui avaient leurs voitures à la porte ! Leurs voitures éternellement inutiles ! Tout ça pour l’amour des pauvres. Oui, tout ça. Quand on est riche, c’est qu’on aime les pauvres. Les belles toilettes sont la récompense de l’amour que l’on a de la pauvreté[17]. » L’incendie lui apparaît donc comme le juste châtiment de la mascarade. Il a ces paroles terribles : « Alors, immédiatement, le FEU a été déchaîné, et TOUT EST RENTRE DANS L’ORDRE.[18] » Est-il possible de suivre jusque là le « Pèlerin de l’absolu[19] » ou Bloy n’est-il qu’un monstre fanatique ? Une chose est sûre, l’homme est inconfortable… Ce sont toutes ces outrances qui ont fini par faire de lui aux yeux de ses contemporains une brute insupportable et c’est peut-être cet extrémisme au nom de la foi qui contribue encore à faire de Bloy pour les manuels scolaires un écrivain infréquentable. On ne peut que le déplorer car c’est priver les jeunes générations de l’œuvre d’un grand prosateur qui manie la langue française à la manière d’un Huysmans énervé. En outre, c’est toujours un sacrilège que de priver quiconque des œuvres d’un thaumaturge avéré. Bloy a converti tout aussi bien Jacques et Raïssa Maritain que Huysmans à sa foi et nul doute que, placé entre de bonnes mains, Bloy pourrait convertir aujourd’hui encore… au culte du verbe iconoclaste, à la littérature de l’irrespect et à la fureur d’écrire. [1] Cf. Léon Bloy, Propos d’un entrepreneur de démolitions, Paris, Tresse, 1884. [2] Belluaires et porchers, cité d’après l’édition 10/18, Paris, 1983, p. 424 [3] Le vieux de la montagne (1907-1910), cité d’après l’édition Robert Laffont, Paris, 1999, p. 131 [4] ibid. [5] ibid. [6] rapporté par Hubert Juin dans sa préface de La femme pauvre, Paris, Union générale d’éditions, coll. 10/18, 1983, p. 10. [7] Belluaires et porchers, cité d’après l’édition 10/18, Paris, 1983, p. 424 [8] Belluaires et porchers, cité d’après l’édition 10/18, Paris, 1983, p. 425. [9] Ibid., p. 435. [10] Propos d’un entrepreneur de démolitions, cité d’après l’édition Mercure de France, Paris, 1964, p. 43. [11] Ibid., p. 55. [12] Albert Béguin, Esprit, n°12, décembre 1958, p. 839 [13] Au seuil de l’Apocalypse (1913-1915), cité d’après l’édition Robert Laffont, Paris, 1999, p. 436 [14] Mon journal, 9 mai 1897, cité d’après l’édition Mercure de France, 1956, p. 222. [15] Ibid., p. 223. [16] Cité par Bloy, ibid. p. 224 [17] ibid. p. 222. [18] Ibid. p. 223. [19] Titre de son journal des années 1910-1912. |
|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Contact e-mail] |